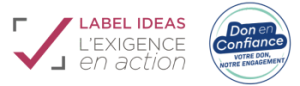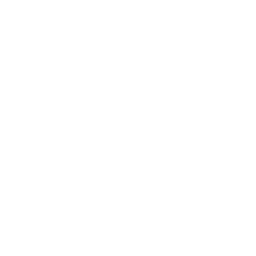Vous allez accueillir ou accueillez des patients atteints de maladies lysosomales, et des questions se posent pour votre équipe.
L’association est à votre disposition à distance ou au sein de vos structures pour rencontrer vos équipes et échanger avec eux.
- L’association
Une association de parents et patients adultes
Représenter les malades et familles
Soutenir la recherche
- Les maladies Lysosomales
- La recherche
L'espoir de guérison
Une expertise partagée
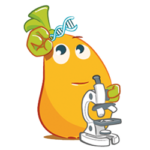
- Nous soutenir
J'agis avec vml - bénévolat
- Les Lyso-Gestes, des idées pour Agir !
- Je crée une page de collecte (challenge - anniversaire ...)
- Je veux être bénévole
- Je veux proposer un projet, une manifestation
- Je propose une Balade du Lysosome
- Je veux être Ambassadeur LysoSolidarité
- Je rejoins le TeamSport du Lysosome
- La Boutique du Lysosome
- Actualités
- Contact
- L’association
Une association de parents et patients adultes
Représenter les malades et familles
Soutenir la recherche
- Les maladies Lysosomales
- La recherche
L'espoir de guérison
Une expertise partagée
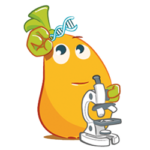
- Nous soutenir
J'agis avec vml - bénévolat
- Les Lyso-Gestes, des idées pour Agir !
- Je crée une page de collecte (challenge - anniversaire ...)
- Je veux être bénévole
- Je veux proposer un projet, une manifestation
- Je propose une Balade du Lysosome
- Je veux être Ambassadeur LysoSolidarité
- Je rejoins le TeamSport du Lysosome
- La Boutique du Lysosome
- Actualités
- Contact