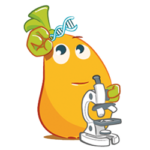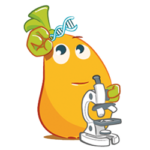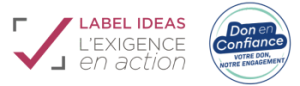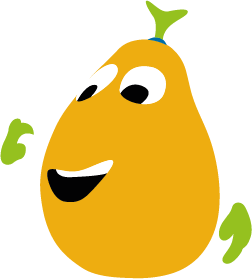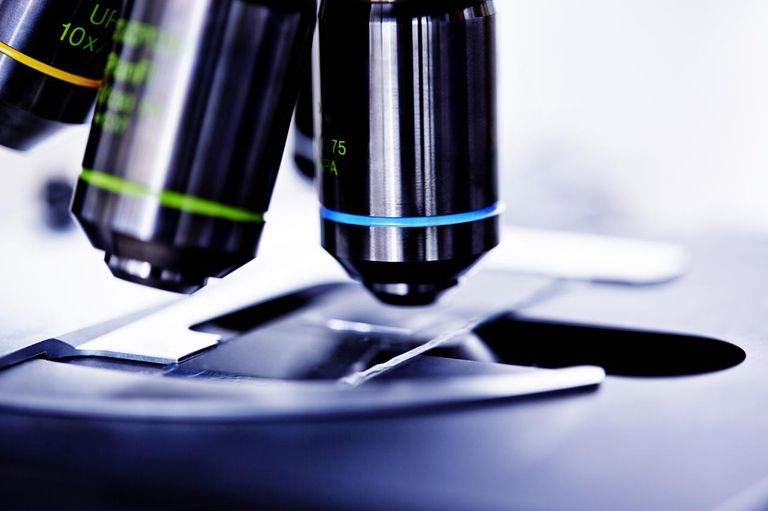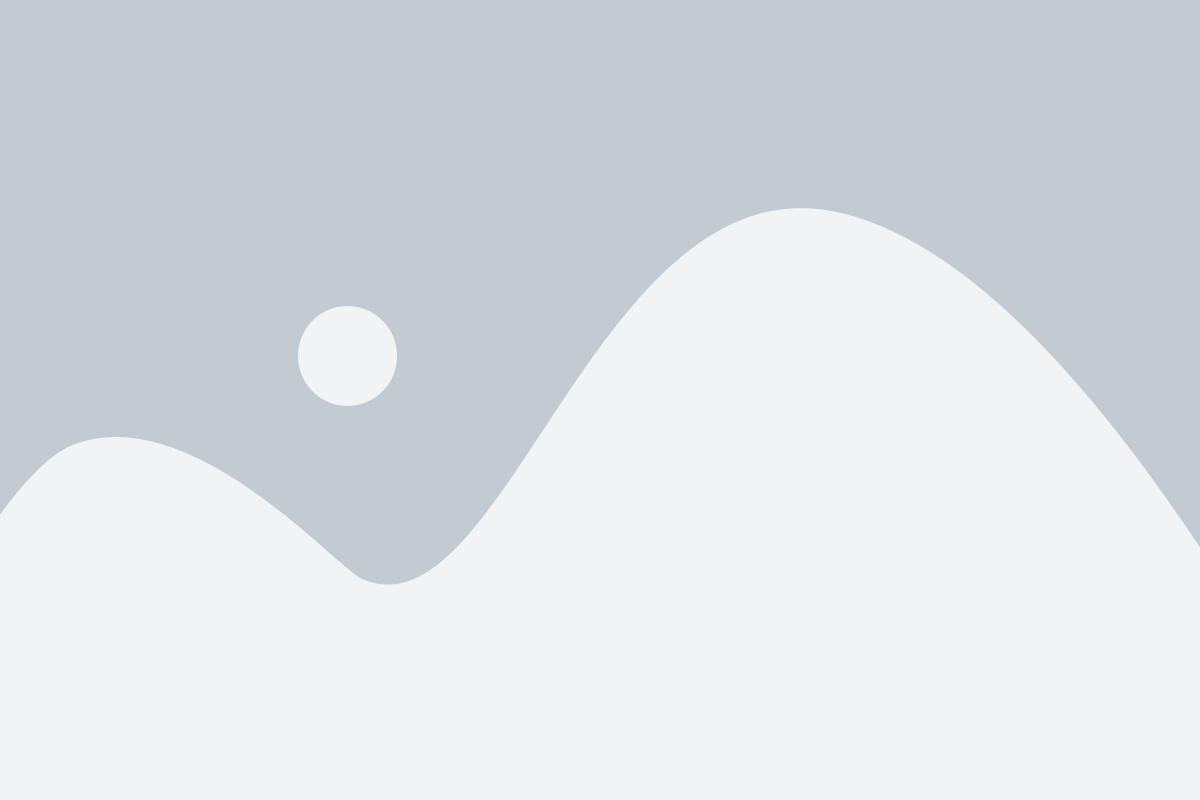Quels sont les 3 types ?
Gangliosidose GM1 Type 1
La gangliosidose à GM1 type 1 est la forme infantile sévère de la gangliosidose GM1 avec des manifestations neurologiques et systémiques variables.
Le type 1 est la forme la plus répandue de gangliosidose à GM1 mais la prévalence exacte est inconnue. Environ 200 cas ont été rapportés à ce jour. La prévalence globale à la naissance est estimée autour de 1/100 000 à 200 000.
La maladie peut se déclarer in utero ou vers l’âge de 6 mois. Les signes cliniques sont variables et incluent l’arrêt ou la régression du développement neurologique, une hypotonie (diminution du Tonus musculaire), une viscéromégalie (augmentation de la taille des organes internes), des tâches rouges-cerise sur le macula de la rétine, une dysostose (malformation osseuse) et un épaississement des traits du visage. On constate parfois une cardiomyopathie (maladie du muscle cardiaque).
Le diagnostic repose sur des signes cliniques bien que ceux-ci ne soient pas toujours présents au moment du diagnostic. Des examens biochimiques et/ou moléculaires permettent de confirmer le diagnostic.
Le pronostic est très mauvais avec une espérance de vie dépassant rarement 2 ans. Les causes de décès incluent la pneumonie due à des inhalations récurrentes et des défaillances cardio-respiratoires.
Gangliosidose GM1 Type 2
La gangliosidose à GM1 type 2 est une forme de gangliosidose GM1 apparaissant dans la petite enfance ou dans l’enfance et présentant des manifestations cliniques variables. Elle se caractérise par un développement initialement normal et une régression psychomotrice entre l’âge de 7 mois et de trois ans.
Le type 2 est moins fréquent que le type 1, mais la prévalence exacte, bien qu’inconnue, est sans doute sous-estimée. Moins de 50 cas ont été rapportés à ce jour. La prévalence moyenne à la naissance est estimée autour de 1/100 000 à 200 000.
Les patients qui présentent la forme infantile de la maladie développent des signes et des symptômes de gravité intermédiaire incluant troubles moteurs, strabisme, faiblesse musculaire, convulsions, léthargie et infections pulmonaires. Comparé au type 1, la viscéromégalie et les anomalies squelettiques sont plus modérées voire absentes. La présence d’une macula rouge-cerise est rare. L’évolution de la maladie est caractérisée par une lente progression. Les traits du visage s’épaississent avec le temps.
Des signes cliniques tels qu’une régression psychomotrice et un épaississement des traits du visage permettent de proposer un diagnostic. Des examens biochimiques et/ou génétiques permettent de le confirmer.
Le pronostic est mauvais, avec une survie jusqu’à la préadolescence ou au début de l’âge adulte.
Gangliosidose GM1 Type 3
La gangliosidose à GM1 type 3 est une forme chronique de gravité moyenne de la ganliosidose GM1 caractérisée par une apparition pendant l’enfance ou l’adolescence et par une dysfonction cérébelleuse.
Le type 3 est une forme moins fréquente de gangliosidose à G1 que le type 1 infantile, mais la prévalence exacte, bien qu’inconnue, semble sous-estimée. Environ 70 cas ont été rapportés à ce jour. La prévalence moyenne à la naissance est estimée autour de 1/100 000 à 200 000. La plupart des cas décrits sont d’origine japonaise.
La maladie se caractérise par une grande variabilité des signes cliniques et de l’âge d’apparition. Les patients évoluent généralement vers une démence progressive, une dysarthrie, une dystonie, une petite taille, des anomalies vertébrales modérées et une ataxie. Les mouvements oculaires sont normaux.
Une dystonie et un langage inarticulé, généralement détecté à l’âge scolaire, permettent de poser le diagnostic. Des examens biochimiques et/ou génétiques permettent de le confirmer..
Le pronostic est variable.